Introduction
Te voilà dans une réunion professionnelle, en interview, ou bien en plein dîner avec tes proches.
Le débat monte. Les échanges se font de plus en plus musclés.
Ton voisin de droite te lâche une pique qui te met un genou à terre.
Puis, tu sens que ta deuxième rotule s'approche doucement du sol aussi, l'autre prend le dessus, tu risques de te retrouver piégé-e.
Comment faire pour garder le contrôle ?
Comment déjouer ses stratagèmes et montrer que TU as raison. Savoir maîtriser la rhétorique et gagner en débat peut être un atout considérable dans toutes les situations.
Heureusement pour toi, Schopenhauer, et moi, sommes là pour t'aider à gagner tes débats ou, du moins, à ne pas te faire écraser.
Dans son ouvrage L'Art d'Avoir Toujours Raison, Schopenhauer dévoile 38 stratagèmes dialectiques éristiques (mot compte double) pour gagner n'importe quelle discussion, peu importe que tu sois dans le vrai ou non.
Pourquoi ?
Parce que, selon lui, avoir raison n’est pas qu’une question de vérité, c’est aussi une question d’image, de vanité, et d'égo.
Notre but ultime en tant qu'être humain ?
Convaincre, convaincre et encore convaincre.
{{cta-pap-style="/cta"}}
Pourquoi veut-on toujours avoir raison selon Schopenhauer ?
La rhétorique et la psychologie humaine sont intimement liées, surtout lorsqu’il s’agit de maîtriser les débats et de défendre ses idées de manière persuasive.
Schopenhauer, dit le S, a un regard bien particulier sur la rhétorique, et pour bien comprendre ses stratagèmes, il faut d'abord saisir la psychologie derrière notre besoin constant d’avoir raison.
Au fond, pourquoi est-ce si important de "gagner" un débat ?
Spoiler alert : il s'agit de bien plus qu'une simple question de vérité ou de bon sens. C'est une affaire d'ego, de reconnaissance, et de survie intellectuelle.
La vanité et le besoin de reconnaissance
D'après le S, tout part de la vanité humaine. La vanité, c’est ce trait de caractère qui nous pousse à attacher une importance démesurée à ce que pensent les autres, et donc à la façon dont nous sommes perçus. Ce besoin de reconnaissance sociale peut aussi être vu comme un aspect du storytelling personnel, où chaque argument devient un moyen de se vendre en public. Voilà pourquoi on stresse de parler devant un public. Ce n’est pas simplement une question de fierté, c’est aussi une question de construction de soi : nous voulons être reconnus et respectés pour nos idées, nos opinions, et ce que nous apportons à une discussion.
Lorsque nous débattons, il y a deux choses en jeu : la question de la vérité objective (qui a vraiment raison ?) et celle de la reconnaissance subjective (qui va être perçu comme ayant raison ?). La plupart du temps, nous privilégions cette deuxième dimension.
Pourquoi ? Parce que notre désir de validation sociale est ancré dans la manière dont nous nous définissons.
Par exemple : En pleine réunion de travail, tu admets devant tout le monde avoir eu tort concernant la mise en place du projet DBGT. Au-delà de simplement reconnaître une erreur factuelle, c’est ton image qui en prend un coup. Tu risques de passer pour quelqu’un qui n’est pas compétent ou pas sûr de ses idées. Et ce besoin de préserver ton image publique (reconnaissance subjective) est plus important que la vérité objective. Même si factuellement, Dragon Ball GT c'était vraiment caca. Dans tout débat et prise de parole, la stratégie de persuasion va au-delà des faits, car l’enjeu est de gagner en crédibilité et en influence.
La peur de la vulnérabilité intellectuelle
Mais ce n’est pas tout. Admettre qu’on a tort, ce n’est pas uniquement une question d’ego, c’est aussi une question de survie intellectuelle.
Schopenhauer explique que nous construisons, tout au long de notre vie, un "édifice de croyances" : une série d’idées, de principes, de valeurs, qui forment le socle de notre vision du monde. Et cet édifice est fragile. Très fragile.
Reconnaître qu’une idée que l’on défend est fausse, c’est ouvrir une fissure dans cet édifice. Et cette fissure, c’est le danger qu’il s’écroule tout entier. Le S nous dit que la vérité est rarement pure et simple. Nos croyances forment un système cohérent, et lorsque ce système est attaqué, nous nous sentons menacés.
En d’autres termes, reconnaître une erreur intellectuelle, c’est prendre le risque de remettre en question toute notre structure de pensée, ce qui peut entraîner une grande insécurité personnelle.
Par exemple : Tu crois fermement en l'efficacité des énergies renouvelables, que tu défends bec et ongles depuis des années. Si quelqu’un te prouve de manière irréfutable qu'elles sont en fait une catastrophe écologique, cela signifie que tu dois repenser entièrement ta vision de l'écologie. Et ça, c’est effrayant. Surtout si tu es abonné-e à Bon Pote.
Le biais de confirmation : renforcer ses propres croyances
Derrière ce besoin de protéger notre édifice de croyances se cache un biais cognitif bien connu : le biais de confirmation. Ce biais est la tendance naturelle de l’être humain à privilégier les informations qui confortent ses croyances existantes, et à ignorer ou dénigrer celles qui les contredisent. Cela signifie que, dans un débat, notre but n’est pas nécessairement de chercher la vérité, mais de confirmer que nous avons raison.
Cela explique pourquoi, face à une contradiction, nous avons tendance à redoubler d'efforts pour défendre notre position, même si les arguments en face sont solides. C’est une manière de préserver notre estime de soi, de protéger notre cohérence intérieure.
Dans le contexte d’une discussion, ce biais nous pousse à sélectionner les arguments qui nous arrangent, à les valoriser, et à discréditer ceux qui pourraient ébranler notre opinion.
Par exemple : Tu es persuadé-e que Dominique est un collègue flemmard. Tout ce qu’il fera sera interprété à travers ce prisme : s’il prend une pause, c’est une preuve de sa paresse ; s’il reste tard au bureau, tu te diras qu’il cherche juste à compenser son manque d'efficacité. Ton esprit a déjà décidé, et tout ce que tu vois ne fait que renforcer cette idée. Biais de confirmation.
En gros, perdre un débat, c’est risquer de perdre la face, d’admettre une faiblesse. Reconnaître qu’on a tort, c’est comme mettre en danger notre système de croyances, cette "structure intérieure" que nous passons des années à bâtir pour interpréter le monde. Alors, forcément, pour défendre ce système, tous les coups sont permis.
C’est là qu'interviennent les stratagèmes de Schopenhauer que j'ai sélectionnés pour toi.
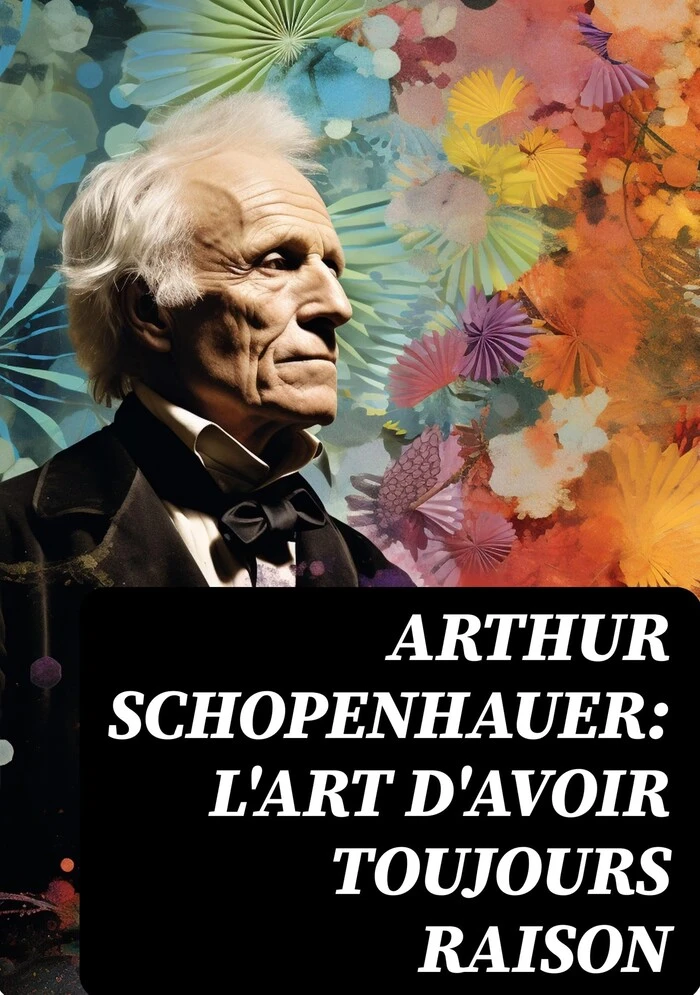
Les 5 stratagèmes pour avoir raison
Stratagème 1 : Bien choisir tes mots
"À force de remporter nos victoires par le vide, la politique est devenue, non plus un dialogue de sourds, mais un débat de muets."
Voici le résumé de la pièce de théâtre de Clément Viktorovitch que je suis allée voir récemment : L'art de ne pas dire (va la voir ou lis le livre, c'est d'utilité publique).
Les mots ont un pouvoir incroyable.
Choisis judicieusement, ils peuvent complètement orienter une discussion.
> L’idée est simple : il s’agit d’utiliser des mots ou des métaphores qui valorisent tes arguments et discréditent ceux de ton adversaire.
Par exemple : Ta boss propose un plan de "modernisation" de la stratégie digitale de la société. Plutôt que de dire qu'elle veut "réformer" ou "changer complètement" la méthode actuelle, elle choisit des termes positifs : "évolution", "amélioration", "modernisation". Le mot "modernisation" porte en lui une connotation positive qui rend son plan difficile à rejeter sans paraître réfractaire au progrès.
Inversement, si elle veut discréditer une idée, elle peut utiliser un mot négativement connoté. En politique, par exemple, on entend souvent parler de "réforme" quand il s’agit de moderniser quelque chose, mais certains opposants peuvent choisir de dire "démantèlement" pour instiller la peur et la désapprobation.
Conseil pratique : Sois attentif aux mots employés dans un débat. Ne te laisse pas piéger par des termes biaisés et reformule les propositions dans tes propres mots pour reprendre le contrôle du cadrage.
On a d'ailleurs écrit un article sur bien choisir ces mots : Comment bien choisir ses mots avant de parler ?
Stratagème 2 : Interrompre et détourner le débat
Celui-ci, tu l'as sûrement déjà expérimenté : tu es en train de construire patiemment ton raisonnement, puis, au moment où tu allais marquer un point décisif, on te coupe la parole. Ton interlocuteur change de sujet ou te lance sur une nouvelle piste. Tu perds le fil et ton argument tombe à l'eau.
> L’idée est simple : il s'agit de détourner l’attention sur autre chose, car il devient difficile de revenir à l'argument initial sans avoir perdu l'impact du discours.
Par exemple : Un collègue te coupe sans cesse quand tu présentes un nouveau projet. Il te pose une série de questions sur des détails sans importance, jusqu’à ce que tu perdes le fil de ta présentation. Résultat ? La réunion s'achève, et ton idée n’a pas pu être développée.
Conseil pratique : Reprends toujours la main sur le sujet initial. Une phrase simple mais efficace : "Revenons à mon argument de départ." Insiste pour finir ce que tu disais avant de te laisser entraîner sur une nouvelle piste.
Stratagème 3 : Trouver une exception pour réfuter la règle générale
Ce stratagème joue sur notre tendance à chercher des cas particuliers pour invalider une affirmation globale. L'esprit humain aime les histoires personnelles. Une anecdote particulière semble souvent plus marquante et plus vraie qu'une statistique générale. Cela donne l'illusion que la règle est fausse ou qu’elle ne s’applique pas dans la réalité.
> L’idée est simple : il s'agit de trouver une contre-exception à une règle générale, ce qui donne l’impression que cette règle n’est pas valable.
Par exemple : Lors d’un débat sur le travail à distance, tu dis : "Le télétravail augmente la productivité." Ton interlocutrice te rétorque : "Oui, mais moi, je connais des gens qui ne supportent pas de travailler chez eux, et ça les rend moins efficaces." Elle vient de trouver une exception pour affaiblir ton argument généralisant.
Conseil pratique : Ne laisse pas une exception détruire une règle. Reviens toujours à la tendance globale : "C’est vrai qu’il existe des cas particuliers, mais la plupart des études montrent que le télétravail augmente la productivité dans la majorité des cas." Garde à l’esprit que l’exception ne confirme que la règle.
Stratagème 4 : Utiliser une association dégradante
Ce stratagème est l'un des plus utilisés en politique et dans les médias. Notre cerveau fait des raccourcis : si une idée est associée à quelque chose de négatif, elle est jugée négative, elle aussi, sans que le fond de l’idée soit réellement discuté.
> L’idée est simple : il s'agit d'associer ton adversaire à une idée ou à une personne mal perçue pour discréditer son discours.
Par exemple : Tu défends une nouvelle stratégie de management inspirée des méthodes de startups. Ton collègue réplique : "Oui, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que fait Amazon avec ses employés, et on sait comment ça s’est terminé pour eux…" Bam, il t’a associé à une idée ou à une entreprise au passif négatif pour disqualifier ta proposition.
Conseil pratique : Recentre la discussion sur le fond : "Peu importe les associations, parlons de ce que je propose réellement." Si tu es pris dans une association dégradante, rappelle que cela n’a aucun lien avec tes arguments et recentre la discussion sur les faits.
Stratagème 5 : Fâcher l’adversaire
Dès qu’une émotion entre en jeu – la colère en particulier – le débat perd en rationalité. Schopenhauer le sait bien : la personne qui s’énerve est celle qui perd le contrôle. La colère fait émerger des réactions impulsives, ce qui peut pousser à la faute, à l’exagération, et au final... à perdre le débat.
> L’idée est simple : il s'agit de faire sortir ton adversaire de ses gonds par tous les moyens.
Par exemple : Tu es au bureau, en train de discuter avec une collègue sur une stratégie de marketing. Le débat est équilibré, jusqu’à ce que, tout à coup, tu te sentes attaqué personnellement. Ta collègue commence à lever la voix, à te couper la parole, à t'attaquer non plus sur tes idées, mais sur ta personnalité. Elle est en train de te "fâcher", tu t'emportes, tu claques la porte, tu glisses à cause de l'agrafeuse par terre, c'est elle qui a gagné.
Conseil pratique : Ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Si tu sens que l'autre essaie de te pousser à bout, garde ton calme. Cela peut être difficile, mais c’est la meilleure façon de rester maître-sse de la discussion. Inspire-toi des stoïciens : ne laisse pas les attaques personnelles t'atteindre. Visualise la discussion comme un jeu, où celui qui reste impassible prend l’avantage (haha plus facile à dire qu'à faire hein. Bah essaye).
{{cta-pap-style="/cta"}}
Devenir un-e boss de la dialectique éristique (ou t’en protéger)
La dialectique éristique n'est pas simplement un ensemble de moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer, réfuter, convaincre.
Elle te permet aussi de mieux comprendre les rouages d’un débat, de saisir les pièges dans lesquels on veut te faire tomber, et de renforcer ta propre capacité de persuasion.
Le vrai défi est de savoir prendre du recul, comprendre les mécanismes en jeu, et savoir choisir tes batailles.
À vouloir toujours avoir raison, tu risques de perdre l’essentiel : la capacité à t'ouvrir aux idées des autres et à progresser dans ta propre pensée.
Et aussi de perdre tes amis, tes collègues, tes proches...
Parfois, il vaut mieux choisir d'être heureux-se que d'avoir raison.
Alors, la prochaine fois que tu te retrouves en pleine joute verbale, souviens-toi : gagner un débat ne signifie pas forcément avoir raison.
Mais si tu maîtrises ces stratagèmes, tu pourras naviguer avec finesse dans le monde complexe des arguments, et surtout... ne pas te laisser piéger.
Conclusion
Maîtriser les stratagèmes de Schopenhauer dans un débat, c’est apprendre à naviguer dans un monde où les idées se confrontent, mais où la forme prime souvent sur le fond.
Ces techniques, utilisées avec finesse, te permettent de garder le contrôle et de convaincre ton interlocuteur, même si tu n’as pas toujours raison.
Mais n’oublie pas : l’objectif n’est pas seulement de gagner à tout prix, mais de savoir faire évoluer ta pensée et celle des autres. Et si, parfois, tu choisis de céder, fais-le avec panache !
Et pour aller encore plus loin, il y a la super chaîne YouTube "Le Précepteur" (chaîne de philo) qui parle également de tout ça pendant 40min dans cette vidéo.
Abonne-toi à notre newsletter mensuelle pour recevoir 1 article complet / mois.
Julien de Sousa, fondateur de Panache.
Aller plus loin
Voici les réponses aux questions qui nous reviennent le plus. Si tu en as d'autres, entre en contact avec nous pour en savoir encore plus.
Pourquoi veut-on toujours avoir raison et comment cela influence-t-il nos débats ?
Le besoin d’avoir raison est profondément ancré dans la psychologie humaine, et il découle en grande partie de notre besoin de validation sociale et de reconnaissance.
Ce désir de toujours gagner dans un débat n’est pas seulement lié à la vérité, mais à la construction de notre image personnelle et à notre estime de soi.
Schopenhauer souligne que nous préférons souvent protéger notre égo plutôt que d'accepter que nous ayons tort, ce qui peut nous pousser à défendre des positions sans fondement solide.
Qu’est-ce que la rhétorique éristique et pourquoi est-elle importante dans un débat ?
La rhétorique éristique, c’est l'art de gagner un débat en utilisant des techniques subtiles et parfois même… un peu fourbes, pour être honnête. Ce n’est pas une question de vérité objective, mais plutôt de perception et de contrôle du discours.
Elle repose sur des stratagèmes qui permettent de manipuler le fil de la conversation, de déstabiliser l’adversaire, et de faire en sorte que, même si tu n’as pas toutes les bonnes réponses, c’est toi qui sembles avoir raison.
C’est crucial dans un débat car, bien souvent, ce n’est pas le contenu de l’argumentation qui prime, mais la manière dont tu réussis à convaincre les autres que tu détiens la vérité. Dominer la rhétorique éristique te permet de transformer chaque débat en une scène où tu es le maître du jeu, dictant le rythme et la direction, avec une touche de panache bien sûr !
Pourquoi la peur de la vulnérabilité intellectuelle est-elle si forte dans un débat ?
La vulnérabilité intellectuelle, c’est cette sensation de fragilité qui survient lorsque tu admets que tu peux avoir tort dans un débat. C’est une situation redoutée, parce qu’au fond, reconnaître une erreur ou une incohérence, c’est comme si tu mettais en péril tout l’édifice de tes croyances, ta vision du monde, ton image.
Schopenhauer l’avait bien compris : notre égo est tellement attaché à nos opinions et à nos idées qu’en admettre la faillibilité, c’est risquer de perdre une partie de notre identité. Mais la vérité, c’est que cette peur de la vulnérabilité est aussi ce qui nous empêche de progresser.
Au lieu de grandir, on se cache derrière nos certitudes. Pourtant, ouvrir son esprit à la remise en question, même si c’est difficile, c’est parfois la meilleure façon d’évoluer, de raffiner sa pensée, et pourquoi pas de dominer la discussion de façon encore plus impressionnante !
Comment appliquer les stratagèmes de Schopenhauer pour avoir raison ?
Appliquer les stratagèmes de Schopenhauer, c’est un peu comme avoir une boîte à outils remplie de techniques astucieuses pour retourner la situation à son avantage.
Par exemple, tu choisis les mots avec soin : les bons mots ont un pouvoir énorme, ils peuvent te faire paraître plus convaincant et mettre en difficulté ton adversaire sans qu’il s’en rende compte. Tu peux aussi interrompre l’autre au bon moment pour le faire sortir de son raisonnement, ou encore utiliser une exception pour invalider une règle générale.
Le but ? Déséquilibrer ton interlocuteur tout en maîtrisant la direction du débat. Ce qui est génial avec ces stratagèmes, c’est qu’ils ne nécessitent pas d’être un expert en la matière, mais une certaine finesse d’esprit et beaucoup de tact.
Utilisés avec discernement, ces stratagèmes font de toi un véritable virtuose des débats. Mais attention à ne pas trop abuser de ces techniques : l’élégance dans l’argumentation réside dans la mesure.




